
La messe à travers les siècles
lefigaro.fr.
Publié le 10 novembre 2006
Actualisé le 12 novembre 2006 : 21h15
Les autres titres
Pour les catholiques, la messe est la cérémonie liturgique au cours de laquelle les prêtres célèbrent le sacrifice du Christ, opéré sur la croix pour le salut de l’être humain.
Jésus institue la messe le Jeudi saint, à
Jérusalem, alors qu’il est à table avec les apôtres, dans le cadre de la
liturgie pascale juive: c'est la Cène, où le Christ annonce sa mort et sa
résurrection pour la rémission des péchés. Les apôtres répètent ensuite ce
mémorial, en y ajoutant des prières liturgiques propres à leurs
communautés.
Ce rituel continue ensuite d'être célébré au temps des persécutions, par les évêques et les prêtres, souvent contraints de se réfugier dans les catacombes, où ils enterrent aussi leurs martyrs. L’habitude est prise de lire un passage d’une lettre écrite par un apôtre, appelée épître, ainsi qu'un passage de la vie et de l'enseignement du Christ consignée par écrit dès la fin du premier siècle.
IVème siècle : avec Constantin, les chrétiens ont licence de construire des églises pour pouvoir y prier et y célébrer la messe dont le cœur reste la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, selon sa recommandation.
3 septembre 590 : Grégoire le Grand (537-604) devient le dernier pape de l’Antiquité ou le premier pape du Moyen-âge. Le soixante-troisième successeur de Pierre conduit pendant près de quatorze ans l’Eglise d’une main de fer : il réorganise l’Eglise romaine, fixe définitivement les textes de la Messe et de la liturgie, notamment par le chant (d'où le chant grégorien). Il réforme aussi la discipline ecclésiastique.
1545-1563 : le concile de Trente confie au pape Pie IV la révision de la célébration de la messe (Missel romain) et des autres sacrements (Rituel romain), la liturgie des heures ou l'office divin (Bréviaire romain) et les autres cérémonies liturgiques (Rituel romain et Caeremoniale Episcoporum). Pie V promulgue les éditions révisées du Bréviaire (9 juillet 1568) et du Missel (14 juillet 1570) et rend obligatoire leur utilisation dans toute l'Eglise latine. Pie V introduit également dans la messe les Prières au bas de l'autel obligatoires et uniformes, et les incorpore à la messe, dont la nature sacrificielle est solennellement affirmée. Ces réformes constituent dès lors le rite tridentin qui reste presqu'inchangé jusqu'au concile Vatican II.
11 octobre 1962 : lors du concile œcuménique susdit, Jean XXIII lance une réforme en profondeur de la liturgie. À partir du 7 mars 1965, l’Église catholique met en œuvre sa réforme liturgique élaborée lors de ce concile. Au nombre des transformations, la messe selon le rite de Saint Pie V est abandonnée, Paul VI publie un nouveau missel en 1969. Le rôle de l'assemblée y est clairement souligné, les officiants peuvent célébrer face aux fidèles pour souligner leur communion, les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, l'usage des langues vernaculaires est facilité (même si le latin reste la langue liturgique officielle). Le cycle liturgique permet une lecture plus étendue de l'ancien et du nouveau testament. "la pompe romaine" veut céder la place au sens du mystère célébré. Le sacrifice de louange des fidèles veut alors être uni plus intimement au sacrifice salvifique du Christ, dans la totalité de son mystère pascal (c'est à dire non plus seulement sa mort, mais aussi sa résurrection).
Cette réforme liturgique interdit la célébration de la messe selon le rite tridentin, sans autorisation explicite, l'unicité du rite soulignant l'unité des fidèles.
Cette autorisation est cependant donnée aux prêtres membres de la Fraternité sacerdotale Saint Pierre et de l'Institut du Bon pasteur. Les évêques peuvent donner l'autorisation dans leur diocèse s'ils le jugent opportun, notamment pour laisser le temps aux fidèles de "digérer" la réforme.
Le prêtre descend de la chaire et se rapproche de l’assemblée, les officiants cessent de tourner le dos aux fidèles, les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, les statues, ornements et guirlandes enlevés des églises. La messe devient une célébration de l’Eucharistie.
21 novembre 1974 : Mgr Lefebvre condamne les réformes de Vatican II et s’insurge contre la «tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement» pendant et après le concile. Il prône notamment une conception formaliste de la tradition et s’insurge contre l’abandon de la messe selon le rite saint Pie V.
1976 : Paul VI suspend Mgr Lefebvre de ses fonctions sacerdotales pour avoir ordonné des prêtres sans autorisation. Le 30 juin 1988, il est également excommunié par Rome pour avoir consacré quatre évêques de sa propre autorité.
Novembre 2006 : Benoît XVI est sur le point de publier un document visant à réhabiliter la messe selon saint Pie V. Toutefois, selon le cardinal des Evêques de France, Mgr Ricard, la rédaction du Motu propio devait prendre du temps, le Pape ayant été sensible aux réticences de plusieurs évêques français.
Ce rituel continue ensuite d'être célébré au temps des persécutions, par les évêques et les prêtres, souvent contraints de se réfugier dans les catacombes, où ils enterrent aussi leurs martyrs. L’habitude est prise de lire un passage d’une lettre écrite par un apôtre, appelée épître, ainsi qu'un passage de la vie et de l'enseignement du Christ consignée par écrit dès la fin du premier siècle.
IVème siècle : avec Constantin, les chrétiens ont licence de construire des églises pour pouvoir y prier et y célébrer la messe dont le cœur reste la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, selon sa recommandation.
3 septembre 590 : Grégoire le Grand (537-604) devient le dernier pape de l’Antiquité ou le premier pape du Moyen-âge. Le soixante-troisième successeur de Pierre conduit pendant près de quatorze ans l’Eglise d’une main de fer : il réorganise l’Eglise romaine, fixe définitivement les textes de la Messe et de la liturgie, notamment par le chant (d'où le chant grégorien). Il réforme aussi la discipline ecclésiastique.
1545-1563 : le concile de Trente confie au pape Pie IV la révision de la célébration de la messe (Missel romain) et des autres sacrements (Rituel romain), la liturgie des heures ou l'office divin (Bréviaire romain) et les autres cérémonies liturgiques (Rituel romain et Caeremoniale Episcoporum). Pie V promulgue les éditions révisées du Bréviaire (9 juillet 1568) et du Missel (14 juillet 1570) et rend obligatoire leur utilisation dans toute l'Eglise latine. Pie V introduit également dans la messe les Prières au bas de l'autel obligatoires et uniformes, et les incorpore à la messe, dont la nature sacrificielle est solennellement affirmée. Ces réformes constituent dès lors le rite tridentin qui reste presqu'inchangé jusqu'au concile Vatican II.
11 octobre 1962 : lors du concile œcuménique susdit, Jean XXIII lance une réforme en profondeur de la liturgie. À partir du 7 mars 1965, l’Église catholique met en œuvre sa réforme liturgique élaborée lors de ce concile. Au nombre des transformations, la messe selon le rite de Saint Pie V est abandonnée, Paul VI publie un nouveau missel en 1969. Le rôle de l'assemblée y est clairement souligné, les officiants peuvent célébrer face aux fidèles pour souligner leur communion, les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, l'usage des langues vernaculaires est facilité (même si le latin reste la langue liturgique officielle). Le cycle liturgique permet une lecture plus étendue de l'ancien et du nouveau testament. "la pompe romaine" veut céder la place au sens du mystère célébré. Le sacrifice de louange des fidèles veut alors être uni plus intimement au sacrifice salvifique du Christ, dans la totalité de son mystère pascal (c'est à dire non plus seulement sa mort, mais aussi sa résurrection).
Cette réforme liturgique interdit la célébration de la messe selon le rite tridentin, sans autorisation explicite, l'unicité du rite soulignant l'unité des fidèles.
Cette autorisation est cependant donnée aux prêtres membres de la Fraternité sacerdotale Saint Pierre et de l'Institut du Bon pasteur. Les évêques peuvent donner l'autorisation dans leur diocèse s'ils le jugent opportun, notamment pour laisser le temps aux fidèles de "digérer" la réforme.
Le prêtre descend de la chaire et se rapproche de l’assemblée, les officiants cessent de tourner le dos aux fidèles, les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, les statues, ornements et guirlandes enlevés des églises. La messe devient une célébration de l’Eucharistie.
21 novembre 1974 : Mgr Lefebvre condamne les réformes de Vatican II et s’insurge contre la «tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement» pendant et après le concile. Il prône notamment une conception formaliste de la tradition et s’insurge contre l’abandon de la messe selon le rite saint Pie V.
1976 : Paul VI suspend Mgr Lefebvre de ses fonctions sacerdotales pour avoir ordonné des prêtres sans autorisation. Le 30 juin 1988, il est également excommunié par Rome pour avoir consacré quatre évêques de sa propre autorité.
Novembre 2006 : Benoît XVI est sur le point de publier un document visant à réhabiliter la messe selon saint Pie V. Toutefois, selon le cardinal des Evêques de France, Mgr Ricard, la rédaction du Motu propio devait prendre du temps, le Pape ayant été sensible aux réticences de plusieurs évêques français.
Pour les catholiques, la messe est la cérémonie liturgique au cours de laquelle les prêtres célèbrent le sacrifice du Christ, opéré sur la croix pour le salut de l’être humain.
Jésus institue la messe le Jeudi saint, à Jérusalem, alors qu’il est à table avec les apôtres, dans le cadre de la liturgie pascale juive: c'est la Cène, où le Christ annonce sa mort et sa résurrection pour la rémission des péchés. Les apôtres répètent ensuite ce mémorial, en y ajoutant des prières liturgiques propres à leurs communautés.Ce rituel continue ensuite d'être célébré au temps des persécutions, par les évêques et les prêtres, souvent contraints de se réfugier dans les catacombes, où ils enterrent aussi leurs martyrs. L’habitude est prise de lire un passage d’une lettre écrite par un apôtre, appelée épître, ainsi qu'un passage de la vie et de l'enseignement du Christ consignée par écrit dès la fin du premier siècle.
IVème siècle : avec Constantin, les chrétiens ont licence de construire des églises pour pouvoir y prier et y célébrer la messe dont le cœur reste la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, selon sa recommandation.
3 septembre 590 : Grégoire le Grand (537-604) devient le dernier pape de l’Antiquité ou le premier pape du Moyen-âge. Le soixante-troisième successeur de Pierre conduit pendant près de quatorze ans l’Eglise d’une main de fer : il réorganise l’Eglise romaine, fixe définitivement les textes de la Messe et de la liturgie, notamment par le chant (d'où le chant grégorien). Il réforme aussi la discipline ecclésiastique.
1545-1563 : le concile de Trente confie au pape Pie IV la révision de la célébration de la messe (Missel romain) et des autres sacrements (Rituel romain), la liturgie des heures ou l'office divin (Bréviaire romain) et les autres cérémonies liturgiques (Rituel romain et Caeremoniale Episcoporum). Pie V promulgue les éditions révisées du Bréviaire (9 juillet 1568) et du Missel (14 juillet 1570) et rend obligatoire leur utilisation dans toute l'Eglise latine. Pie V introduit également dans la messe les Prières au bas de l'autel obligatoires et uniformes, et les incorpore à la messe, dont la nature sacrificielle est solennellement affirmée. Ces réformes constituent dès lors le rite tridentin qui reste presqu'inchangé jusqu'au concile Vatican II.
11 octobre 1962 : lors du concile œcuménique susdit, Jean XXIII lance une réforme en profondeur de la liturgie. À partir du 7 mars 1965, l’Église catholique met en œuvre sa réforme liturgique élaborée lors de ce concile. Au nombre des transformations, la messe selon le rite de Saint Pie V est abandonnée, Paul VI publie un nouveau missel en 1969. Le rôle de l'assemblée y est clairement souligné, les officiants peuvent célébrer face aux fidèles pour souligner leur communion, les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, l'usage des langues vernaculaires est facilité (même si le latin reste la langue liturgique officielle). Le cycle liturgique permet une lecture plus étendue de l'ancien et du nouveau testament. "la pompe romaine" veut céder la place au sens du mystère célébré. Le sacrifice de louange des fidèles veut alors être uni plus intimement au sacrifice salvifique du Christ, dans la totalité de son mystère pascal (c'est à dire non plus seulement sa mort, mais aussi sa résurrection).
Cette réforme liturgique interdit la célébration de la messe selon le rite tridentin, sans autorisation explicite, l'unicité du rite soulignant l'unité des fidèles.
Cette autorisation est cependant donnée aux prêtres membres de la Fraternité sacerdotale Saint Pierre et de l'Institut du Bon pasteur. Les évêques peuvent donner l'autorisation dans leur diocèse s'ils le jugent opportun, notamment pour laisser le temps aux fidèles de "digérer" la réforme.
Le prêtre descend de la chaire et se rapproche de l’assemblée, les officiants cessent de tourner le dos aux fidèles, les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, les statues, ornements et guirlandes enlevés des églises. La messe devient une célébration de l’Eucharistie.
21 novembre 1974 : Mgr Lefebvre condamne les réformes de Vatican II et s’insurge contre la «tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement» pendant et après le concile. Il prône notamment une conception formaliste de la tradition et s’insurge contre l’abandon de la messe selon le rite saint Pie V.
1976 : Paul VI suspend Mgr Lefebvre de ses fonctions sacerdotales pour avoir ordonné des prêtres sans autorisation. Le 30 juin 1988, il est également excommunié par Rome pour avoir consacré quatre évêques de sa propre autorité.
Novembre 2006 : Benoît XVI est sur le point de publier un document visant à réhabiliter la messe selon saint Pie V. Toutefois, selon le cardinal des Evêques de France, Mgr Ricard, la rédaction du Motu propio devait prendre du temps, le Pape ayant été sensible aux réticences de plusieurs évêques français.




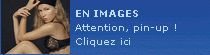
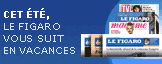



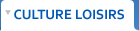


















 Retour | Rubrique
France
Retour | Rubrique
France.gif)




 Les flux
RSS du Figaro.fr
Les flux
RSS du Figaro.fr